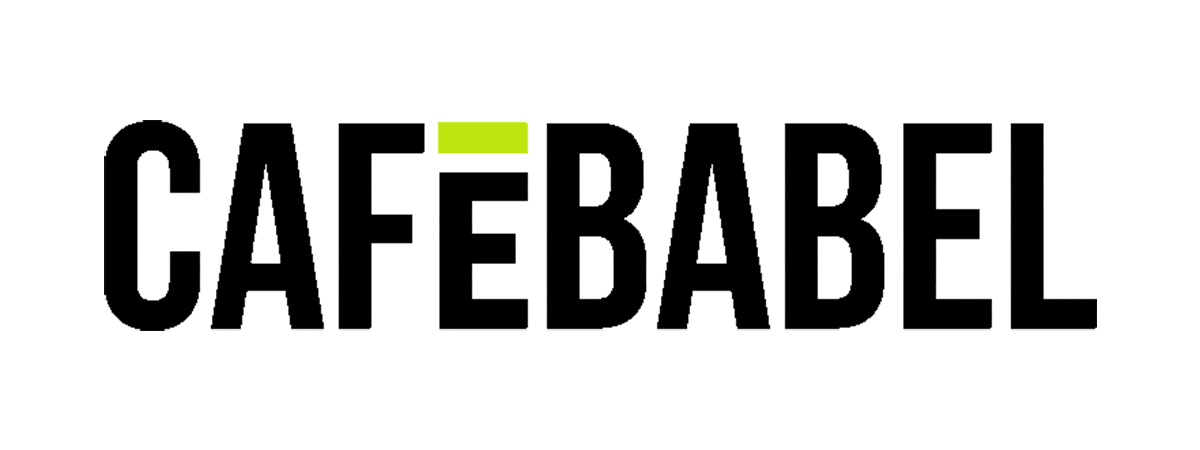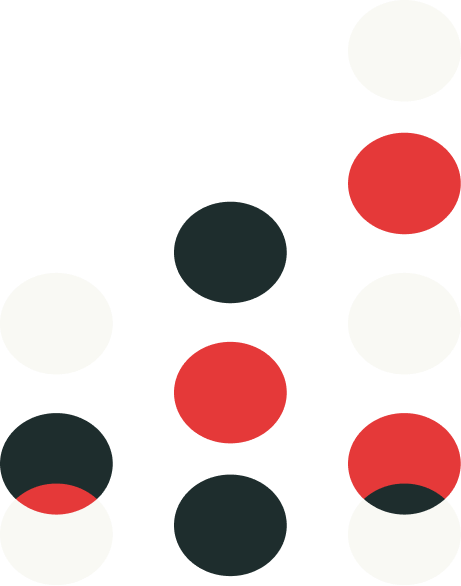Charlottenburg : les eurosceptiques du Berlin russe
Published on
Translation by:
 emmanuelle.m
emmanuelle.m
Au début des années 1920, le quartier de Charlottenburg, à Berlin, était surnommé « Charlottengrad » en raison de la vague d’immigrants russes venus dans ce district après la révolution bolchevique. Aujourd’hui, la capitale allemande héberge entre 200 000 et 300 000 russophones. Se considèrent-ils comme une communauté de citoyens européens ?
Au supermarché Rossiya, à côté de la gare de Charlottenburg, impossible d’échapper aux dumplings et au vin russe, ainsi qu’à la vodka et au traditionnel chocolat Alyonka. Le lieu semblait tout indiquer pour bien débuter ma visite du Berlin russe. Le magasin propose également un petit étalage de maquillage, puisque d’après ce que l’on me dit, « les filles russes ne font confiance qu’aux produits fabriqués en Russie ». Les vendeurs portent tous le même t-shirt rouge, sur lequel on peut lire le mot « Russie », écrit en lettres cyrilliques bleues et blanches.
 La mode russe mise à part, il convient de parler de communauté russophone à Berlin, ses membres venant de différentes régions et appartenant à divers groupes ethniques. « En fait, on recense trois groupes », explique Stefan Melle dans le bureau de son organisation d'échange germano-russe. « Il y a tout d’abord les réfugiés 'accidentels', puis les juifs issus de l’ancienne Union soviétique présents ici grâce à un accord avec l’Allemagne. Mais la plus grande partie de cette communauté est d’origine allemande. Le troisième groupe est plus diversifié, puisque ses membres sont originaires de plusieurs anciennes républiques soviétiques », ajoute-t-il.
La mode russe mise à part, il convient de parler de communauté russophone à Berlin, ses membres venant de différentes régions et appartenant à divers groupes ethniques. « En fait, on recense trois groupes », explique Stefan Melle dans le bureau de son organisation d'échange germano-russe. « Il y a tout d’abord les réfugiés 'accidentels', puis les juifs issus de l’ancienne Union soviétique présents ici grâce à un accord avec l’Allemagne. Mais la plus grande partie de cette communauté est d’origine allemande. Le troisième groupe est plus diversifié, puisque ses membres sont originaires de plusieurs anciennes républiques soviétiques », ajoute-t-il.
LE BERLIN RUSSE
L’organisation de Stefan a aidé les migrants à s’intégrer en Allemagne, surtout pendant les années 1990. Mais les nouveaux arrivants se font dorénavant plus rares. « Il s’agit désormais de la deuxième ou troisième génération de migrants. Ils montent leurs propres business, envoient leurs enfants dans des écoles bilingues. Ils sont très bien intégrés ».
 Pourtant, le concept d'un Berlin russe des années 1920 reste réel aux yeux des anciennes générations, qui mènent une vie « comme en Russie » dans la capitale allemande. « Certaines personnes n’ont jamais appris à parler allemand, affirme David, un jeune Allemand aux origines russes, qui habite à Berlin avec son épouse russe, « et j’imagine que leur vision du monde correspond à celle de la Russie. Après tout, ils suivent essentiellement l’actualité grâce aux médias de là-bas. »
Pourtant, le concept d'un Berlin russe des années 1920 reste réel aux yeux des anciennes générations, qui mènent une vie « comme en Russie » dans la capitale allemande. « Certaines personnes n’ont jamais appris à parler allemand, affirme David, un jeune Allemand aux origines russes, qui habite à Berlin avec son épouse russe, « et j’imagine que leur vision du monde correspond à celle de la Russie. Après tout, ils suivent essentiellement l’actualité grâce aux médias de là-bas. »
Par conséquent, il semble peu probable que ces Berlinois ressentent un quelconque sentiment d’appartenance à l’Union européenne, à laquelle ils font pourtant partie. En effet, « ils s’identifient davantage aux Etats-nations, et non aux organisations transnationales », confirme Stefan. « C’est l’Allemagne qui est perçue de manière positive, grâce à sa quiétude et à sa stabilité, plutôt que l’UE. » David acquiesce, mais rajoute : « depuis les événements en Ukraine, les relations entre l’UE et la Russie sont particulièrement discutées. »
« L'UE est un échec »
Le mot est lâché. Inévitablement, la crise ukrainienne plane sur ma visite du Berlin russophone. Pourtant, selon Stefan, le véritable tournant dans la perception de l’UE a eu lieu en 2008. « Pour beaucoup, la crise a signifié la fin de l’UE comme garantie de bien-être. L’UE est apparue comme faible, incapable de redresser son économie. En 2008 a également eu lieu le conflit en Géorgie, au cours duquel l’UE semblait avoir une lecture fausse et hâtive de la situation. »
Cette vision extrêmement négative de l’Union n’a pas beaucoup changé depuis, bien au contraire. Une impression confirmée lorsque David me présente au Père Andrej, le corpulent barbu et légèrement intimidant prêtre de l’une des églises orthodoxes russes de Charlottenburg. Le Père Andrej semble très respecté au sein de la communauté : alors que nous nous rendons à son bureau, il est révérencieusement salué par les visiteurs de la paroisse, dont beaucoup déposent leurs enfants aux cours de langue et de religion du dimanche.
 Lorsque je l’interroge sur sa vision de l’intégration européenne, le prête se montre catégorique. « L’UE est un échec. Ici, au sein de la paroisse, nous discutons de la politique européenne. Nous nous demandons tous quand l’UE s’effondrera. Qui croit à ce projet européen de toute façon ? Un projet de paix, vraiment ? Et qu’en est-il des conflits en Irlande du Nord ? Ou de l’animosité entre les Allemands et les Grecs ? », questionne-t-il.
Lorsque je l’interroge sur sa vision de l’intégration européenne, le prête se montre catégorique. « L’UE est un échec. Ici, au sein de la paroisse, nous discutons de la politique européenne. Nous nous demandons tous quand l’UE s’effondrera. Qui croit à ce projet européen de toute façon ? Un projet de paix, vraiment ? Et qu’en est-il des conflits en Irlande du Nord ? Ou de l’animosité entre les Allemands et les Grecs ? », questionne-t-il.
Tout en blâmant l’UE pour sa docilité et sa peur, elle qui s’aplatit naïvement devant les Etats-Unis sur la question ukrainienne, le Père Andrej se montre légèrement plus doux envers son pays de résidence. « Nous avons une responsabilité envers l’Etat allemand, dont nous sommes pour beaucoup citoyens. Mais certainement pas envers l’UE. »
LA GUERRE DE LA PROPAGANDE
De nombreux membres de la communauté dénoncent les effets pernicieux des médias, responsables selon eux du fossé de plus en plus grand entre la Russie et l’Union. Pendant que le Père Andrej met en garde contre « une propagande de guerre », en citant quelques vagues exemples vus lors de la couverture américaine de la guerre de Géorgie en 2008, David se veut plus prudent, mais affirme tout de même retrouver sur les les Unes des journaux occidentaux « des stéréotypes qui vous rappellent la Guerre Froide ».
 Il ajoute : « souvenez-vous de l’image de Volker Beck (politicien allemand) battu par des Russes agressifs, homophobes et hostiles. Cette image a été figée dans les esprits, il n’y avait aucun moyen de se défendre. Alors que la Russie est fière d’être une nation européenne, les gens ici tendent à voir le pays comme un lointain pays oriental, voire asiatique. Je crois que nous avons besoin de plus de représentants qui réunissent les deux côtés. »
Il ajoute : « souvenez-vous de l’image de Volker Beck (politicien allemand) battu par des Russes agressifs, homophobes et hostiles. Cette image a été figée dans les esprits, il n’y avait aucun moyen de se défendre. Alors que la Russie est fière d’être une nation européenne, les gens ici tendent à voir le pays comme un lointain pays oriental, voire asiatique. Je crois que nous avons besoin de plus de représentants qui réunissent les deux côtés. »
EN ATTENDANT MERKEL
Est-ce à l’Allemagne de remplir ce rôle ? Après tout, le pays possède un héritage historique d’unification entre l’Est et l’Ouest, et est actuellement gouvernée par une chancelière qui parle couramment russe. Pendant ce temps, son homologue russe maintient des liens étroits avec le pays dans lequel il a été affecté pendant cinq ans. « L’Allemagne est un acteur essentiel, mais ils ont commis de grosses erreurs en s’ingérant dans le conflit ukrainien. Merkel est respectée, aussi bien en Russie que dans notre communauté russophone. Elle fait ce qu’elle peut, mais elle ne s’oppose pas aux Américains », maugrée le Père Andrej.
 David est moins critique envers sa patrie. Il est cependant convaincu que l’Allemagne devrait améliorer la relation précaire entre l’UE et la Russie. « Quand je vois tout le potentiel dont bénéficie l’Allemagne, et que je constate que des opportunités sont sous-exploitées, ça me met hors de moi. L’Allemagne doit devenir un médiateur et collaborer avec la Russie. Sinon, des mouvements comme le Front national ou Jobbik le feront, mais pas au bénéfice de l’Europe », s'insurge-t-il.
David est moins critique envers sa patrie. Il est cependant convaincu que l’Allemagne devrait améliorer la relation précaire entre l’UE et la Russie. « Quand je vois tout le potentiel dont bénéficie l’Allemagne, et que je constate que des opportunités sont sous-exploitées, ça me met hors de moi. L’Allemagne doit devenir un médiateur et collaborer avec la Russie. Sinon, des mouvements comme le Front national ou Jobbik le feront, mais pas au bénéfice de l’Europe », s'insurge-t-il.
CE REPORTAGE A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROJET « EUTOPIA – TIME TO VOTE » à berlin. NOS PARTENAIRES POUR CE PROJET SONT LA FONDATION HIPPOCRÈNE, LA COMMISSION EUROPÉENNE, LE MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA FONDATION EVENS. VOUS TROUVEREZ BIENTÔT TOUS LES ARTICLES SUR Berlin EN UNE DE NOTRE MAGAZINE.


Translated from Charlottengrad Revisited: The Cold-Hearted Europeans of Russian Berlin